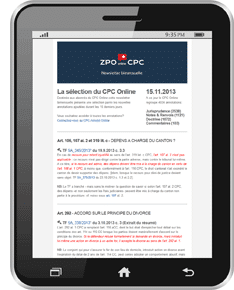[Recours contre une décision de rejet d’une demande de récusation (art. 50 al. 2 CPC) – indication inexacte du délai de recours par le tribunal – recours tardif] On ne saurait considérer que le délai de recours contre une décision de récusation ressort de la seule lecture de la loi. La jurisprudence retenant le critère de la lecture de la législation, selon laquelle les arrêts publiés ” aux ATF ” n’ont pas de portée pour juger de la bonne foi, ne peut toutefois pas être reprise sans autre, sans tenir compte des circonstances concrètes. En l’occurrence, cette question du délai de recours a précisément été clarifiée récemment par l’ATF 145 III 469. Ce dernier est très clair s’agissant du délai de recours de 10 jours, lequel est d’ailleurs même indiqué explicitement dans le regeste. Cet ATF a été publié au Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral plus d’un an avant le prononcé de la décision attaquée. Or, sous l’angle de la responsabilité de l’avocat, ce dernier doit, selon une pratique constante, connaître la jurisprudence publiée. Par son mandataire, la recourante se devait de connaître la jurisprudence topique, laquelle avait à ce moment déjà été publiée au recueil précité. Retenir le contraire serait incompatible avec la jurisprudence concernant la responsabilité de l’avocat. Ainsi, la recourante, assistée par son mandataire, aurait dû procéder à un examen sommaire des voies de droit et se rendre compte de l’indication erronée. N’ayant pas prêté l’attention commandée par les circonstances, elle ne peut se prévaloir de la protection de sa bonne foi.
2022-N15 Indication erronée des voies de droit : l’avocat doit connaître la jurisprudence publiée… Surtout si le tribunal l’ignore
Note F. Bastons Bulletti
1 Dans sa décision de rejet d’une demande de récusation, le tribunal indique que le recours est ouvert dans un délai de trente jours. A tort : selon la jurisprudence publiée, le délai de recours est de dix jours (ATF 145 III 469 c. 3.2-3.3, cf. note sous art. 50 al. 2 et in newsletter 2019-N26). Dans le délai indiqué, mais après la fin du délai de dix jours, l’une des parties, assistée d’un avocat, introduit un recours. Celui-ci déclaré tardif et irrecevable. Elle recourt au TF, invoquant sa confiance dans l’indication des voies de droit par le premier juge. Le TF admet que le délai de recours contre une décision en matière de récusation ne ressort pas d’une simple lecture du texte légal, mais rejette néanmoins le recours, au vu des circonstances du cas concret.
2 Le tribunal est tenu d’indiquer les voies de droit dans sa décision (art. 238 lit. f CPC) et cette indication, qui comprend la voie et le délai de recours, doit être adaptée au cas particulier (TF 4A_475/2018 du 12.9.2019 c. 5.1 et 5.2 n.p. in ATF 145 III 469, note sous art. 238 lit. f et in newsletter 2019-N26 ; ég. TF 4D_32/2021 du 27.10.2021 c. 5.2).
3 En principe, une éventuelle erreur ne peut causer aucun préjudice aux plaideurs. Ce principe ne s’applique cependant qu’à celui qui ne connaissait pas – directement ou par son mandataire – cette inexactitude, ni ne pouvait la reconnaître en faisant preuve de l’attention usuelle. La protection de la confiance est ainsi refusée à la partie dont la négligence est grossière, ce qui s’apprécie eu égard à ses connaissances juridiques et aux circonstances concrètes (ATF 135 III 374 c. 1.2.2.1 et réf., note sous art. 52, C.c.).
4 Dans la pratique, lorsque le plaideur est représenté par un avocat, les exigences posées à la protection de la confiance s’avèrent élevées : il n’est certes attendu du mandataire qu’un contrôle dit « sommaire » de l’indication des voies de droit. Ainsi, en principe, la protection n’est exclue que lorsqu’une lecture des dispositions de procédure applicables permettait de déceler l’erreur. A contrario, la protection doit être accordée lorsque l’erreur ne pouvait être repérée qu’en consultant la jurisprudence – même publiée – ou la doctrine (cf. notes ibid., not. ATF 138 I 49 c. 8.3.2 et 8.4 ; ATF 141 III 270 c. 3.3). Néanmoins, d’une part, la lecture attendue de l’avocat implique, au besoin, une démarche systématique, combinant plusieurs dispositions légales (cf. ATF 141 précité, ibid.). D’autre part, la protection de la confiance est parfois aussi refusée, même si l’erreur ne peut être mise en évidence par la lecture des dispositions légales, lorsqu’eu égard aux circonstances du cas concret, l’avocat devait être en mesure de déceler cette erreur (cf. TF 5A_706/2018 du 11.1.2019 c. 3.3, note ibid. et in newsletter 2019-N14 [cas où le recourant avait lui-même cité la jurisprudence dont résultait le délai de recours applicable]; TF 4A_475/2018 du 12.9.2019 c. 5.2 n.p. in ATF 145 III 469, note ibid. et in newsletter 2019-N26 [cas où l’avocat avait déjà recouru, dans la même affaire, contre une décision identique, en indiquant lui-même correctement le délai de recours]).
5 Le présent arrêt va plus loin, en refusant à l’avocat la protection de la confiance eu égard à la publication récente, au recueil officiel des ATF, d’un arrêt très clair sur le délai de recours en matière de récusation (ATF 145 III 469 précité, supra N 1). Au contraire des deux cas précédemment cités (TF 5A_706/2018 et TF 4A_475/2018, supra N 4), le TF, bien qu’il se réfère aux « circonstances concrètes » (c. 4, 3e § de l’arrêt), n’a pas constaté qu’en l’espèce, l’avocat connaissait effectivement la jurisprudence en cause, mais a relevé qu’il devait la connaître, dès lors que son devoir de diligence le lui impose. Ainsi, tout en rappelant formellement que l’avocat n’est pas tenu de vérifier une indication des voies de droit en compulsant la doctrine ou la jurisprudence (supra N 4 et c. 3 de l’arrêt), c’est bien un tel manquement que le TF lui reproche en l’espèce.
6 En soi, l‘exigence que l’avocat connaisse la jurisprudence (même récemment) publiée, n’est pas nouvelle (cf. ATF 134 III 534 c. 3.2). Elle fait partie des devoirs de l’avocat envers son client et s’applique lorsqu’il s’agit d’apprécier sa responsabilité envers celui-ci. Dans ce cadre, elle n’est nullement exagérée. Cependant, en l’espèce, il ne s’agit pas de savoir si l’avocat a violé son devoir de diligence envers son client, mais si envers l’autorité qui lui a donné une indication erronée, il est de bonne foi, de sorte que sa confiance doit être protégée. Or, à cet égard, la jurisprudence (publiée, cf. ATF 138 et 141 précités, supra N 4) est claire : sous réserve de circonstances particulières (ainsi s’il est avéré que l’avocat connaît, voire applique, la jurisprudence que le tribunal a ignorée, de sorte qu’il ne pouvait que reconnaître l’erreur, cf. supra N 4 i.f. ; cf. cep. newsletter 2019-N14 n° 4), à l’égard des indications données par le tribunal, l’avocat n’est précisément pas censé connaître, mieux que le juge, la jurisprudence et la doctrine. Il peut dès lors invoquer sa bonne foi s’il s’est fié, sans la vérifier, à une indication contraire à celles-ci. En privant ici l’avocat de la protection de sa confiance, au motif qu’il ne peut pas de bonne foi ignorer une jurisprudence publiée, claire et récente, le TF contredit ces principes, sans que l’on discerne en quoi la publication d’un arrêt « clair » aux ATF constituerait une circonstance particulière, propre au cas d’espèce, imposant cette dérogation. Au contraire, la motivation de l’arrêt pourrait aussi bien être opposée à tout avocat qui s’est simplement fié à l’indication erronée du tribunal, après avoir opéré le contrôle sommaire du texte légal qui lui est seul imposé (supra N 4). Ainsi, la solution donnée revient en définitive, contrairement à la jurisprudence à cet égard, à contraindre les avocats à contrôler dans tous les cas l’indication des voies de droit non seulement au regard de la loi, mais aussi à la lumière de la jurisprudence publiée.
7 Nous pensons que ces exigences vont trop loin, en finissant par inverser les rôles. Selon la volonté du législateur, c’est au tribunal – lui aussi censé connaître la jurisprudence publiée – qu’il incombe d’indiquer correctement les voies de droit (supra N 2), et non à l’avocat de rechercher en tous sens si l’indication est exacte, sous peine, à défaut, que son client ne supporte les conséquences d’une erreur – statistiquement inévitable – du juge. Cette solution est en outre source d’insécurité, car l’avocat peut parfois légitimement hésiter sur le fait qu’une jurisprudence publiée s’applique ou non au cas qu’il traite : les nuances sont parfois subtiles, surtout lorsque des arrêts ultérieurs les apportent. Il devrait dans ce cas, par prudence, élaborer un mémoire compatible avec les deux voies de droit possibles (appel et recours) et/ou le déposer dans le délai le plus court entrant en considération, au détriment de sa qualité. Il aura d’autant plus intérêt à se résigner à cette démarche que de jurisprudence constante, s’il choisit, en définitive à tort, une voie de droit différente de celle indiquée par le tribunal, on lui reprochera une négligence grossière, excluant toute conversion (cf. notes sous art. 132 al. 1, B.b.b., p.ex. TF 5A_46/2020 du 17.11.2020 c. 4.1.2, note in newsletter 2021-N6 n° 2; ég. TF 5A_221/2018 du 4.6.2018 c. 3.3.2).
8 Dans le cadre de la révision en cours du CPC, la commission de justice du Conseil national a aussi relevé cette rigueur générale de la jurisprudence, qu’elle a trouvée excessive. Elle a proposé un nouvel art. 52a CPC, que le Conseil national a adopté en séance du 10.5.2022 (cf. BO 2022 N 670 s., 673 et 687 s.). La disposition, intitulée « Interprétation de la loi et protection de la confiance », tend à protéger sans limites les plaideurs, en énonçant : « (al. 1) Les tribunaux interprètent les règles de procédure en tenant compte de l’accès à la justice des parties. (al. 2) Les indications erronées relatives aux voies de droit et aux délais figurant dans une décision ou une ordonnance d’instruction relevant de la présente loi sont opposables à tous les tribunaux. ». A suivre ce projet, diamétralement opposé à la pratique actuelle, les avocats n’auraient plus de devoir de contrôle : la confiance dans l’indication erronée du tribunal devrait être systématiquement protégée – sous réserve sans doute de l’abus de droit manifeste (art. 52 CPC), dont l’application doit cependant rester exceptionnelle.
9 A noter en outre que selon les travaux législatifs du Conseil national, l’énumération d’affaires soumises à la procédure sommaire, selon les art. 249, 250, 251, 251a et 305 CPC, devrait devenir exhaustive, le terme « notamment » y étant supprimé (cf. BO 2022 N 672 et 708 s.). Ainsi, selon la commission de justice, la récusation (art. 47 – 50 CC) ne devrait plus être soumise à la procédure sommaire (BO 2022 N 672, intervention Lüscher). En conséquence, le délai pour déposer le recours prévu par l’art. 50 al. 2 CPC pourrait passer de 10 à 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). En effet, selon l’ATF 145 III 469 précité (supra N 1), en matière de récusation seule l’application de la procédure sommaire justifie le délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC) : la décision attaquée n’est pas une ordonnance d’instruction (également attaquable dans les 10 jours, cf. art 321 al. 2 CPC), mais une « autre décision » au sens de l’art. 319 lit. b ch. 1 CPC (cf. ATF 145 précité et note in newsletter 2019-N26 n° 9). Si la norme proposée est adoptée, les tribunaux et les plaideurs seront bien avisés d’examiner les dispositions transitoires, pour ne pas appliquer trop tôt le délai plus long.
Proposition de citation:
F. Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2022-N15, n°…