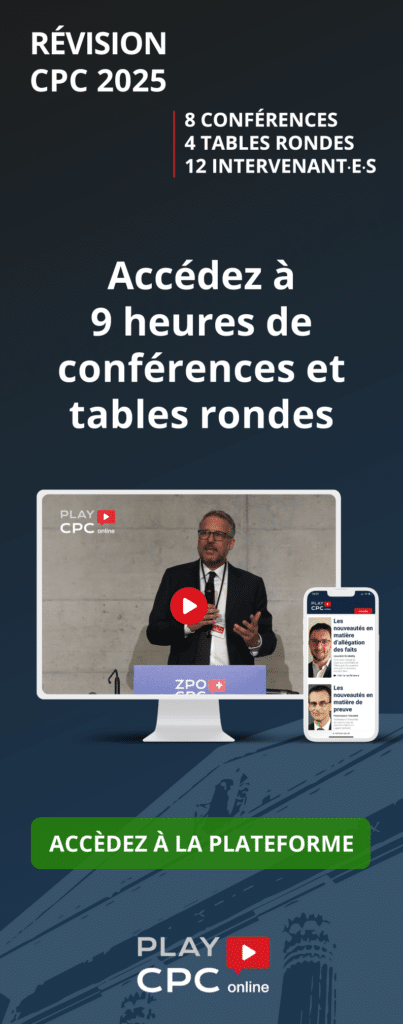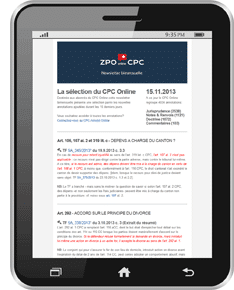2024-N13 – L’art. 407f nCPC : étrange disposition transitoire de la révision du CPC
Note Sara Grunho Pereira – Michel Heinzmann – Françoise Bastons Bulletti
1 Dans le cadre de la révision du CPC qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025, le législateur a adopté l’art. 407f à titre de disposition transitoire. Loin d’être évidente, cette disposition pose de nombreuses questions. Après nous être attardés sur la règlementation transitoire à l’entrée en vigueur du CPC (1.) et le contexte de la révision du CPC (2.), nous nous pencherons sur la manière d’interpréter l’art. 407f (3.). Cette contribution est également l’occasion d’exposer aux praticiennes et praticiens les effets de l’application immédiate de certaines dispositions (4.) ainsi qu’un intérêt éventuel à retarder l’introduction d’une action en justice (5.).
2 Le TF applique par analogie le principe de l’art. 2 Tit. fin. CC aux règles de procédure (ATF 115 II 97 c. 2c, JdT 1989 I 544 ; ATF 137 II 409 c. 7.4.5 [procédure administrative]). En règle générale, celles-ci sont donc immédiatement applicables à leur entrée en vigueur.
3 Le législateur a en partie dérogé à ce principe lors de l’adoption du CPC en prévoyant des dispositions transitoires (Titre 3 de la Partie 4; art. 404 ss). Les art. 404 à 407 (« Chapitre 1: Dispositions transitoires du 19 décembre 2008 ») sont consacrés au passage du droit cantonal procédural au CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011. L’art. 404 traite de l’application de l’ancien droit, l’art. 405 prévoit une réglementation spéciale pour les voies de droit, l’art. 406 pour l’élection de for et l’art. 407 pour la convention d’arbitrage. Les dispositions transitoires des chapitres 2 à 6 (art. 407a à 407e) concernent les modifications ultérieures du CPC et prescrivent toutes en principe l’application immédiate des nouvelles dispositions.
4 L’art. 404 prévoit que les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. L’entrée en vigueur du CPC a introduit des modifications importantes dans la pratique de la procédure civile en Suisse. Il se justifiait dès lors d’introduire cette disposition transitoire dérogeant au principe général d’application immédiate du nouveau droit et de maintenir l’application de l’ancien droit dans les procédures en cours, afin de ne pas les compliquer davantage. Le CPC a été appliqué aux procédures dont la litispendance a débuté à partir du 1er janvier 2011. Cette règle permet de respecter les principes d’économie de procédure et de sécurité du droit tout en protégeant la bonne foi des parties (PC CPC-Heinzmann/Grunho Pereira, art. 404 N 4).
5 En ce qui concerne les voies de droit, le législateur a adopté une disposition transitoire distincte. Selon l’art. 405, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (al. 1). La notion de voie de droit doit être comprise au sens large et englobe tant l’appel (art. 308 ss) et le recours (art. 319 ss) que la rectification et l’interprétation (art. 334 ; ATF 139 III 379 c. 2.3, note sous art. 334, B.2.a.). La notion de « communication de la décision » correspond à la date de l’envoi du dispositif (ATF 137 III 127 c. 2; 137 III 130 c. 2, notes sous art. 405 al. 1, B.). L’annulation de la décision et le renvoi de la cause à l’instance précédente implique pour cette dernière de reprendre la procédure au stade où elle se trouvait, en appliquant l’ancien droit (TF 4A_641/2011 du 27. 1. 2012 c. 2.2, note sous art. 405 al. 1, C.). Quant à la révision de décisions communiquées en application de l’ancien droit, elle est régie par le nouveau droit (art. 405 al. 2).
6 Selon l’art. 406, la validité d’une élection de for est régie par le droit en vigueur au moment de la conclusion de la convention. Si elle a été conclue avant le 1er janvier 2001, le droit cantonal ou le droit fédéral alors en vigueur est applicable. Si elle a été conclue entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2010, l’art. 9 LFors s’applique. Lorsque l’élection de for a été conclue à partir du 1er janvier 2011, sa validité est soumise à l’art. 17 CPC. L’art. 406 ne s’applique pas aux effets de l’élection de for, qui sont analysés selon le CPC dès son entrée en vigueur. Ainsi, selon l’art. 17 al. 1 2e phr., l’élection de for est exclusive sauf accord contraire des parties (DIKE ZPO-Füllemann, art. 406 N 3; PC CPC-Heinzmann/Grunho Pereira, art. 406 N 6; cf. ég. ATF 129 III 80, c. 2.4 et les réf. cit., JdT 2003 I 636 [art. 39 LFors]).
7 L’art. 407 règle les questions de droit transitoire en lien avec les conventions d’arbitrage. Son al. 1 prévoit l’application du droit le plus favorable à l’analyse de la validité d’une convention d’arbitrage. Les procédures arbitrales en cours à l’entrée en vigueur du CPC sont soumises à l’ancien droit à moins que les parties conviennent d’appliquer les art. 353 ss (art. 407 al. 2). Les procédures d’appui en cours le 1er janvier 2011 sont également régies par l’ancien droit, les parties n’ayant ici pas la possibilité de convenir de l’application du CPC (art. 407 al. 4). S’agissant des voies de recours, l’art. 407 al. 3 correspond à l’art. 405, c’est-à-dire qu’elles sont déterminées par le droit applicable au moment de la communication de la sentence arbitrale (PC CPC-Heinzmann/Grunho Pereira, art. 407 N 7; Message CPC 2006, 7013).
8 Les dispositions transitoires des chapitres 2 à 6 concernent des révisions ultérieures du CPC portant sur les règles relatives à la tenue du procès-verbal du 28 septembre 2012 (art. 407a), le droit de l’entretien de l’enfant du 20 mars 2015 (art. 407b), le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce du 19 juin 2015 (art. 407c), l’amélioration de la protection des victimes de violence du 14 décembre 2018 (art. 407d) et le droit de la protection des données du 25 septembre 2020 (art. 407e). Le législateur a repris le principe général de l’applicabilité immédiate du droit dès son entrée en vigueur, sous réserve de quelques particularités dans les domaines du droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance professionnelle (art. 407b al. 2 et 407c al. 2).
9 D’autres révisions du CPC n’ont pas fait l’objet de dispositions transitoires spécifiques (p. ex. la modification des art. 5 al. 1 let. h, 40 al. 2, 270 al. 1). Dans ce cas, nous préconisons l’application du principe général précité, à savoir l’application immédiate du droit révisé à son entrée en vigueur (supra N 2). En effet, les dispositions transitoires des art. 404 à 407, placées dans un chapitre particulier (chapitre 1) du titre 3 de la 4e partie du CPC, visaient la situation singulière de l’entrée en vigueur du CPC et du passage du droit cantonal procédural au droit fédéral. Des révisions de moindre importance ne devraient pas être soumises à ce régime-là en l’absence de disposition spécifique prévue dans le CPC (voir PC CPC-Heinzmann/Grunho Pereira, art. 404 N 12 s.; contra: BSK ZPO-Willisegger, art. 407f N 2).
10 La révision du CPC a été adoptée par les chambres le 17 mars 2023 et entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Elle vise à faciliter l’accès à la justice pour les justiciables (Message CPC 2020, 2608). Elle a mené à l’adoption ou la modification de nombreuses dispositions, mais il ne s’agit pas d’une révision profonde du CPC. Beaucoup de modifications se limitent à codifier ou corriger la jurisprudence ou à clarifier certains points, de sorte que matériellement, l’on trouve en définitive peu de véritables innovations.
11 L’avant-projet daté de 2018 et le projet du 26 février 2020 ne prévoyaient pas de dispositions transitoires. La question se posait alors de savoir si les dispositions révisées devaient être immédiatement applicables selon le principe de l’art. 2 Tit. fin. CC ou s’il fallait suivre les principes transitoires des art. 404 à 407 CPC. L’application immédiate des dispositions révisées semblait alors la solution la plus appropriée puisqu’il ne s’agissait pas d’une révision en profondeur de la procédure civile, comparable à l’adoption du CPC unifié (PC CPC-Heinzmann/Grunho Pereira, art. 404 N 14).
12 Lors des débats parlementaires, les chambres ont toutefois adopté une disposition transitoire, l’art. 407f, qui prévoit qu’une série de normes révisées est immédiatement applicable aux procédures en cours. Cette disposition a été adoptée sur proposition des commissions des affaires juridiques des deux Conseils. Celles-ci n’étaient pas d’accord sur la liste des articles concernés (notamment les art. 63 al. 1, 141a, 141b et 239 al. 1 nCPC). À la suite de la procédure d’élimination des divergences, les deux chambres ont adopté l’art. 407f dans sa teneur définitive qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025 (BO 2021 E 693; BO 2022 N 710 s.; BO 2022 E 651; BO 2022 N 2262 ; BO 2023 E 10; BO 2023 N 219; BO 2023 E 244 s.; BO 2023 N 528 ss).
a) Le système
13 L’art. 407f dispose que les art. 8 al. 2 2e phrase, 63 al. 1, 118 al. 2 2e phrase, 141a, 141b, 143 al. 1bis, 149, 167a, 170a, 176 al. 3, 176a, 177, 187 al. 1 3e phrase et 2, 193, 198 let. bbis, f, h et i, 199 al. 3, 206 al. 4, 210 al. 1 phrase introductive et let. c, 239 al. 1, 298 al. 1bis, 315 al. 2 à 5, 317 al. 1bis, 318 al. 2, 325 al. 2, 327 al. 5 et 336 al. 1 et 3 s’appliquent également aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023.
14 Les dispositions citées à l’art. 407f sont applicables immédiatement aux procédures pendantes au 1er janvier 2025. A contrario, les autres dispositions révisées ne bénéficient pas de l’application immédiate ; en d’autres termes, elles ne s’appliquent qu’aux procédures qui ne sont pas déjà « en cours » au 1er janvier 2025. L’interprétation de l’art. 407f pose plusieurs questions. Puisque cette disposition a été adoptée par les chambres sans débats parlementaires, il est difficile d’identifier la volonté du législateur.
15 La question principale qui se pose est celle de savoir ce qu’on doit comprendre par procédure « en cours ». La réponse à cette question permet de dire à partir de quel moment le nCPC est entièrement applicable.
16 Dans les textes allemand et italien, le législateur a utilisé une expression faisant référence à la notion de litispendance (« rechtshängig » et « pendenti »). Or, la litispendance est créée dès le dépôt de l’acte introductif d’instance (art. 62 al. 1 CPC) et elle perdure jusqu’à la clôture de la dernière instance – i.e., en général, à l’entrée en force de la décision ou de son substitut (PC CPC-Chabloz art. 62 N 20 ss). À suivre cette notion, le nCPC (hormis les articles cités à l’art. 407f) ne serait jamais applicable à une procédure introduite avant le 1er janvier 2025 (Tappy, N 7) – même si seule une requête de conciliation a été déposée avant cette date. À notre avis, cette conception doit être écartée. Il s’agirait sinon d’une dérogation importante au principe général de l’applicabilité immédiate (supra N 2). En prenant en compte la durée d’une procédure de première et de seconde instances, l’application des dispositions révisées serait retardée de plusieurs années. Telle ne peut être la volonté du législateur (du même avis, du moins en ce qui concerne la deuxième instance, pour laquelle il préconise l’application de l’art. 405: Tappy, ibid.; BSK ZPO-Willisegger, art. 407f N 16). Pour le droit transitoire, une conception monolithique de la « procédure en cours » ne peut donc pas être retenue.
17 Dans cette situation d’ambiguïté, voire de mutisme de la loi, la plupart des auteurs qui se prononcent à ce sujet préconise l’application (par analogie) des art. 404 et 405 CPC, prévoyant une réglementation distincte pour les voies de droit (supra N 4 s.). Ainsi l’ancien droit demeurerait applicable aux procédures de première instance pendantes au 1er janvier 2025, mais la procédure de deuxième instance serait régie par le nouveau droit si la décision contestée a été communiquée aux parties après cette date (Balmer, p. 565; Hofmann/Lüscher, p. 429; Tappy, N7; voir aussi DIKE ZPO-Müller, art. 407a N1; BSK ZPO-Willisegger, art. 407f N7 et 17). Cependant, le système de l’art. 407f s’abstient autant d’une référence globale au principe de l’application immédiate, qui ne concerne qu’une partie de cette révision (supra N 13 s.), que d’une quelconque référence aux art. 404 à 407. Sa structure est au demeurant tout autre: alors que l’art. 404 concerne la première instance précédée éventuellement de la procédure de conciliation et que l’art. 405 vise la procédure de voie de droit, l’art. 407f mentionne des dispositions touchant tant à la procédure de conciliation, à la première instance qu’à la seconde instances cantonales. En outre, non seulement l’art. 407f ne renvoie pas aux art. 404 à 407, mais il se situe dans un chapitre distinct du Code (chapitre 7 du titre 3, et non chapitre 1 du titre 3). Ainsi, rien – ni le texte de l’art. 407f, ni les travaux législatifs, ni la systématique de la loi – n’indique que l’on puisse faire référence aux art. 404 à 407 pour interpréter l’art. 407f, étant en outre rappelé que ces dispositions ont été édictées dans le contexte particulier du passage des codes cantonaux au nouveau CPC unifié. Or, le contexte est tout autre dans le cas de la simple révision de ce CPC (supra N 10).
18 Il en résulte en particulier que le terme « en cours » ne signifie pas que la première instance serait délimitée de la seconde instance cantonale par la communication du dispositif de la décision. Retenir cette hypothèse reviendrait à appliquer au moins par analogie l’art. 405, c’est-à-dire à soumettre la procédure de seconde instance au droit applicable au moment de la communication de la décision (en faveur d’une telle interprétation : Hofmann/Lüscher, p. 429 ; Tappy, N 8 ; BSK ZPO-Willisegger, art. 407f N 17). Cette interprétation doit à notre avis être rejetée, car l’application du nCPC se retrouverait alors retardée. En effet, le délai s’écoulant entre la notification de la décision et le dépôt de l’appel ou du recours peut être important, notamment en cas de décision communiquée sans motivation écrite (art. 239 al. 1). Or, selon la jurisprudence, la communication du dispositif de la décision et non la décision motivée suffit (ATF 137 III 127 c. 2, note sous art. 405 al. 1, B.). Par conséquent, la communication d’un dispositif intervenue avant le 1er janvier 2025 mènerait à l’application du CPC non-révisé jusqu’au terme de la seconde instance, même si l’appel ou le recours est introduit plusieurs mois plus tard, dans le délai déclenché par la notification de la décision motivée (art. 239 al. 2; art. 311 al. 1 et 321 al. 1) (inconvénient soulevé par BALMER, p. 565 et évoqué par Tappy, N 8). Il s’agirait là encore d’une dérogation importante au principe général de l’applicabilité immédiate. Le fait que le législateur de 2023 n’ait directement soumis à ce principe que certaines des dispositions adoptées (art. 407f) ne permet pas encore d’en déduire, à l’opposé, qu’il aurait accepté que l’application des autres dispositions puisse être retardée de plusieurs années, alors qu’il n’a donné aucune indication en ce sens, p.ex. sous forme de simple renvoi aux art. 404 ss. Il faut au contraire retenir, eu égard à la portée modérée de la révision (supra N 10), que son application peut et doit avoir lieu sans tarder.
19 L’application des art. 404 à 407 devant ainsi être exclue, il reste à déterminer quelle interprétation de la notion de « procédure en cours » correspond le mieux à la nécessité susmentionnée d’appliquer sans (trop de) retard les dispositions révisées non mentionnées à l’art. 407f. A cet égard, le fait que l’art. 407f se rapporte indistinctement à toutes les étapes procédurales, sans régler le droit de procédure applicable globalement à l’une ou l’autre d’entre elles (au contraire des art. 404 et 405), est un indice pour considérer chacune de ces étapes de manière indépendante, à savoir la procédure devant l’autorité de conciliation, celle devant le tribunal de première instance et enfin la seconde instance cantonale (sur le caractère indépendant de la procédure d’appel par rapport à la procédure de première instance, cf. p. ex. TF 5A_469/2019 du 17.11.2020 c. 5.4.2 et réf.; sur la délimitation entre la procédure de conciliation et celle de première instance cf. not. ATF 138 III 615 c. 2, note sous art. 209 al. 3 et 4). On peut ainsi admettre que chacune de ces phases du procès est « en cours » à partir du moment où l’écriture qui introduit cette phase a été déposée, jusqu’à son achèvement par la délivrance d’une autorisation de procéder ou par une décision finale motivée (infra N 27 ss) – ou un substitut de décision (art. 241 CPC). Cela revient à considérer que chaque phase procédurale est séparée des autres et peut être « en cours » de manière autonome.
20 Cette solution empêche un retard dans l’application du nCPC, résultant notamment du laps de temps potentiellement important entre la communication du dispositif de la décision de première instance – moment décisif pour déterminer le droit applicable en deuxième instance si l’on retient l’application analogique de l’art. 405 (supra N 17 s.) – et l’introduction de l’appel ou du recours. Au contraire, la solution que nous préconisons permet de tendre vers une application rapide du nCPC: si un appel est introduit avant le 1er janvier 2025, le droit de procédure non-révisé reste applicable, sous réserve des dispositions citées à l’art. 407f, alors qu’en cas de dépôt d’un tel acte à partir de cette date, le nCPC trouvera application, même si la décision attaquée a été communiquée aux parties avant le 1er janvier 2025.
21 Notre solution distingue également la phase de conciliation de la phase de première instance. La phase de conciliation s’achève, au plus tard, à la délivrance de l’autorisation de procéder (ATF 138 III 615 c. 2.3, note sous art. 209 al. 3 et 4), alors que la phase procédurale de première instance débute par le dépôt de la demande au tribunal (art. 220). Il en résulte, en cas de conciliation préalable, que les opérations de procédure devant l’autorité de conciliation et la procédure de première instance peuvent ne pas être soumises au même droit de procédure, si la demande est déposée après le 1er janvier 2025, et ce même si l’autorisation de procéder a été délivrée en 2024 (sur le délai de validité de l’autorisation de procéder cf. infra N 27 s.). Là encore, une application rapide du nCPC est assurée.
22 En cas de renvoi de l’instance supérieure à l’instance inférieure, celle-ci reprend la procédure au stade où elle se trouvait avant de se prononcer et applique le droit qui était applicable à ce moment-là (TF 4A_641/2011 du 27. 1. 2012 c. 2.2). Lorsqu’une décision de renvoi concerne une décision rendue en application du CPC non-révisé, l’instance inférieure doit appliquer le CPC non-révisé, sous réserve des dispositions citées à l’art. 407f qui sont (cette fois) applicables dès le 1er janvier 2025. Le fait que la seconde instance, par hypothèse saisie après le 1er janvier 2025, applique un droit de procédure (nCPC) différent de la première instance ne pose ainsi pas de problème, à moins que la seconde instance ne décide de compléter elle-même l’instruction selon le nCPC (TF 4A_641/2011 du 27. 1. 2012 c. 2.2, note sous art. 405 al. 1, C.). Pour assurer une application uniforme du droit de procédure en ce qui concerne les opérations de première instance, l’autorité d’appel ou de recours devrait préférer renvoyer la cause à l’instance inférieure en cas d’instruction défaillante, comme le permettent les art. 318 al. 1 let. c et 327 al. 3 let. a. L’instance inférieure peut alors compléter l’instruction selon le droit qu’elle a précédemment appliqué à celle-ci, sous réserve de l’application immédiate des dispositions visées à l’art. 407f: elle peut p. ex. auditionner un témoin à l’aide des moyens électroniques de transmission du son et de l’image (cf. art. 170a, cité à l’art. 407f).
23 La solution la plus satisfaisante consiste ainsi à retenir que par l’expression « procédure en cours », le législateur vise non pas la litispendance au sens de l’art. 62, mais bien chaque phase du procès, à savoir la procédure de conciliation, la première instance et la seconde instance cantonales, qui sont des phases procédurales distinctes. Chacune d’elles est considérée « en cours » à partir du moment où l’acte qui l’introduit (requête en conciliation, demande au fond ou appel/recours) est déposé et jusqu’à ce que l’acte final ait été rendu (autorisation de procéder, décision finale ou substitut de décision). Autrement dit, tout acte introductif de l’une de ces phases du procès, s’il est déposé à partir du 1er janvier 2025, provoque l’application du nCPC.
24 Se posent encore quelques questions particulières. Sans avoir la prétention d’être exhaustifs, nous en abordons une série ci-dessous.
b) Quelques cas d’application de la réglementation transitoire
i. La décision selon l’art. 212 CPC
25 Selon l’art. 212 al. 1, l’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 2’000.-. Avant de rendre une décision, l’autorité tient une audience de conciliation et rend une ordonnance d’instruction qui constate l’échec de la conciliation au procès-verbal ainsi que l’ouverture de la procédure au fond (PC CPC-Clément, art. 212 N 6). La phase décisionnelle est ainsi distincte de la procédure de conciliation en tant que telle.
26 S’agissant d’une procédure de conciliation introduite avant le 1er janvier 2025, le nCPC doit à notre avis s’appliquer à la phase décisionnelle si l’ordonnance d’instruction marquant le début de la procédure au fond est rendue à partir du 1er janvier 2025. Si l’autorité venait à changer d’avis et renonçait à prononcer une décision au fond (ATF 142 III 638 c. 3.4, note sous art. 212 al. 1), la procédure de conciliation reprendrait selon le CPC non-révisé. P. ex. à la suite d’une requête de conciliation introduite en 2024, l’autorité peut rendre une ordonnance d’instruction en janvier 2025 marquant le début de la procédure au fond sous l’empire du nCPC, reconsidérer ensuite cette décision, reprendre la procédure de conciliation sous le CPC non-révisé et rendre une proposition de décision au sens de l’art. 210 al. 1 let. c révisé (désormais applicable, cf. art. 407f).
ii. Le délai de validité de l’autorisation de procéder
27 La réserve de l’art. 209 al. 4 en faveur des autres délais d’action légaux ou judiciaires est supprimée dans le cadre de la révision. Cette suppression ne figure pas à l’art. 407f. La question se pose donc de savoir quel droit régit le délai pour introduire l’action en fond, lorsqu’un autre délai d’action légal pourrait s’appliquer (étant souligné que la réserve des délais d’action judiciaires est de toute manière sans portée, cf. ATF 140 III 561 c. 2.2.1, note sous art. 209 al. 3 et 4).
28 La phase de conciliation s’achève, au plus tard, à la délivrance de l’autorisation de procéder (ATF 138 III 615 c. 2.3, note sous art. 209 al. 3 et 4) alors que la phase procédurale de première instance débute par le dépôt de la demande au tribunal (art. 220) (supra N 21). Dès lors que l’existence d’une autorisation de procéder valable et par conséquent, le respect du délai de validité de l’autorisation de procéder (art. 209), conditionne la recevabilité de la demande (ATF 139 III 273 c. 2.1, note sous art. 59 al. 2, B.a.), le calcul de ce délai doit s’opérer selon le droit applicable à la première instance. Or, la procédure devant celle-ci doit à notre avis être soumise au nouveau droit si le dépôt de la demande au tribunal a lieu en 2025, même si l’autorisation de procéder a été délivrée en 2024 (supra N 21; en revanche, en application de l’art. 404, l’on ne distinguerait pas entre la procédure de conciliation et la première instance: ATF 138 III 792 c. 2.3 et 2.6, note sous art. 404 al. 1, B.). Il en résulte, notamment, que le délai pour déposer la demande au tribunal après échec de la conciliation dans une action en validation du séquestre, qui n’est que de 10 jours selon la réserve figurant à l’art. 209 al. 4 CPC non-révisé cum art. 279 al. 2 LP (cf. Message 2006, p. 6941), peut se trouver rétrospectivement porté à 3 mois (art. 209 al. 3 CPC et 209 al. 4 nCPC), si la demande est déposée au tribunal, dans ce délai, en 2025, même si l’autorisation de procéder a été délivrée en 2024. Pour éviter toute contestation et tout risque de caducité du séquestre, la prudence commandera néanmoins aux mandataires de respecter le délai applicable au jour du dépôt de la requête de conciliation. En effet, si la solution proposée ici n’est pas retenue, le délai de l’art. 279 al. 2 LP sera encore applicable si la requête de conciliation a été déposée avant le 1er janvier 2025, même si la demande doit être déposée en 2025.
iii. La motivation de la décision
29 Le tribunal de première instance est dessaisi de la cause au moment où la décision est arrêtée (TF 4A_61/2023* du 25.6.2024 c. 5.2.1). Cela étant, puisque le tribunal ne peut plus modifier sa décision par la suite, il convient de considérer la phase de motivation comme le prolongement de la phase décisionnelle. La procédure de première instance est donc « en cours » jusqu’à ce que la décision motivée ait été rendue (supra N 19), de sorte que la motivation d’une décision d‘abord communiquée sans motivation (art. 239 al. 1) s’inscrit encore dans la procédure de première instance. Ainsi, lorsque le dispositif est communiqué sous le CPC non-révisé (avant le 1er janvier 2025) mais que la décision est motivée en 2025, la motivation est régie par le CPC non-révisé. Il en va de même pour la motivation des décisions de deuxième instance, sous réserve cependant des art. 318 al. 2 et 327 al. 5 nCPC, immédiatement applicables selon l’art. 407f (infra N 48).
iv. Les voies de droit
30 S’agissant des délais pour intenter les voies de droit, on remarque que les délais révisés (art. 314 al. 2 et 321 al. 2 nCPC) ne figurent pas à l’art. 407f. La question se pose donc de savoir quel droit régit les délais.
31 Le respect du délai pour intenter la voie de droit est une condition de recevabilité de celle-ci. Le délai est ainsi intimement lié à la voie de droit correspondante, de sorte qu’il devrait être régi par le même droit. Un argument supplémentaire est le fait que le délai de réponse à l’appel et l’appel joint sont réglés dans la même disposition (art. 314 al. 2 nCPC). Si le délai pour l’appel joint fait indéniablement partie de la procédure d’appel et est régi par le même droit applicable à la voie de droit, le délai pour intenter la voie de droit doit également être régi par le droit applicable à cette dernière.
32 Ainsi, les délais révisés s’appliquent pour les voies de droit introduites à partir du 1er janvier 2025, même si la décision attaquée a été communiquée en 2024, ce qui permet également l’application plus rapide du nouveau droit (contra: Hofmann/Lüscher, p. 429 pour lesquels les nouveaux délais s’appliquent à la contestation des décisions communiquées dès l’entrée en vigueur, en application de l’art. 405; supra N 17 s.). Dans le cas contraire, les délais révisés ne trouveraient application que lorsque les dispositifs de première instance sont notifiés après le 1er janvier 2025.
33 Partant, les parties devraient disposer d’un délai de 30 jours pour déposer un appel (art. 314 al. 2 nCPC) contre une décision motivée portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale communiquée le 19 décembre 2024. En effet, l’appel peut être déposé en 2025 et être donc régi par le nCPC. Nous avons néanmoins bien conscience du risque pris par les avocats et avocates dans cet exemple. Puisque cette question n’a pas été tranchée, un plaideur prudent déposera son appel dans le délai de 10 jours voulu par l’art. 314 al. 1 (non sujet aux suspensions, cf. art. 145 al. 2). On remarque au passage qu’en déposant son appel contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale en décembre 2024, l’appelant empêche la partie intimée de former un appel-joint (qui n’est admis qu’à l’art. 314 al. 2 nCPC).
34 On remarque encore que les art. 315 al. 4 et 5 et 325 al. 2 nCPC, qui permettent aux parties de requérir la suspension du caractère exécutoire ou bien l’exécution anticipée, sont immédiatement applicables dès le 1er janvier 2025 (art. 407f). La question du droit applicable à cette question n’est donc pas controversée.
v. Le grief de la mauvaise application du droit
35 Il faut distinguer le droit qui régit la voie de droit de celui appliqué pour l’analyse des griefs. Ainsi, une instance d’appel ou de recours est régie par le nCPC si la voie de droit est introduite à partir du 1er janvier 2025. Cela étant, si cette instance est saisie pour une mauvaise application du CPC en première instance, l’analyse de la violation du droit se fait à l’aune du droit appliqué par l’instance inférieure, par hypothèse le CPC non-révisé. Cela reviendrait sinon à appliquer le nouveau droit à titre rétroactif, ce qui n’est pas admissible (ATF 149 III 145 c. 2.6.1, JdT 2023 II 259).
vi. Les procédures arbitrales
36 Aucune des dispositions révisées concernant l’arbitrage interne ne figure à l’art. 407f. Elles ne devraient alors être applicables qu’aux procédures arbitrales introduites à partir du 1er janvier 2025. Les parties peuvent néanmoins librement décider de la procédure arbitrale applicable (art. 373 al. 1). Elles pourraient ainsi décider d’appliquer le nCPC avant le 1er janvier 2025. Cela revient à retenir un système transitoire similaire à l’art. 407 al. 2 (PC CPC-Heinzmann/Grunho Pereira, art. 407 N 5 s.). La situation est différente pour les procédures d’appui (art. 356) qui sont de la compétence des tribunaux étatiques (PC CPC-Göksu, art. 356 N 13). Ceux-ci appliquent le nCPC (art. 356 al. 3 2e phr.) uniquement aux procédures d’appui introduites à partir du 1er janvier 2025 (équivalent de l’art. 407 al. 4; PC CPC-Heinzmann/Grunho Pereira, art. 407 N 9 s.).
37 L’art. 407f crée un effet d’anticipation de la révision du CPC, pour les dispositions immédiatement applicables selon l’art. 407f. Sachant qu’une procédure peut durer plusieurs mois voire années, ces dispositions doivent être prises en compte par les praticiens dans les procédures introduites déjà en 2024. Cet effet est plus utile pour certaines dispositions que pour d’autres.
38 – Art. 8 al. 2 2e phr.: Cette disposition prévoit que le tribunal supérieur qui est compétent pour les actions directes est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant la litispendance. Cet ajout n’est que la concrétisation de la pratique connue jusqu’alors (Honegger-Müntener/Rufibach/Schumann, p. 1161), de sorte que l’application immédiate de cette disposition n’a pas de réelle utilité.
39 – Art. 63 al. 1 et 143 al. 1bis: L’art. 143 al. 1bis permet à une partie qui a introduit par erreur sa requête ou sa demande devant une autorité de conciliation incompétente ou un tribunal suisse incompétent de sauvegarder les délais. L’acte est alors transmis d’office, ce qui préserve la litispendance (art. 63 al. 1 nCPC). Ces deux dispositions étant citées à l’art. 407f, les tribunaux et les autorités de conciliation devront les appliquer à partir du 1er janvier 2025, même s’agissant d’actes introduits avant cette date. Puisque l’analyse de la recevabilité se fait en général à réception de l’acte (ATF 140 III 159 c. 4.2.4, note sous art. 60, B.), l’effet anticipé de ces dispositions ne devrait concerner que les actes introduits en fin d’année 2024, sous réserve d’une procédure introduite plus tôt mais suspendue par le tribunal ou l’autorité de conciliation (art. 126).
40 – Art. 118 al. 2 2e phr.: L’assistance judiciaire peut aussi être accordée pour la procédure de preuve à futur. Cette nouvelle disposition corrige la jurisprudence du TF (ATF 140 III 12 c. 3.3, JdT 2016 II 293, note sous art. 117, B.; Honegger-Müntener/Rufibach/Schumann, p. 1177). L’effet anticipé touche les procédures encore pendantes le 1er janvier 2025. Compte tenu de la rapidité de cette procédure (comme la procédure de mesures provisionnelles ; art. 158 al. 2), seules les requêtes introduites en fin d’année 2024 devraient être concernées par l’effet anticipé de cette disposition, sous réserve d’une suspension de la procédure. Or l’assistance judiciaire n’est en principe pas accordée rétroactivement (art. 119 al. 4). Il est néanmoins possible que certains frais (p. ex. les frais pour une expertise) soient couverts, dans la mesure où l’événement qui les provoque – l’ordonnance d’expertise – se produit en 2025.
41 – Art. 141a, 141b, 170a, 176 al. 3, 176a, 193, 298 al. 1bis: Le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image sera autorisé dans les procédures civiles pendantes au 1er janvier 2025. Les praticiens peuvent donc déjà requérir l’utilisation de tels moyens à la fin de l’année 2024 en prévision d’audiences qui se dérouleront en 2025. À noter que l’art. 133 let. d nCPC, qui règle le contenu de la citation en cas de recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image, ne figure pas à l’art. 407f. Il s’agit sans doute d’un oubli du législateur (Honegger-Müntener/Rufibach/Schumann, p. 1187). Par conséquent, l’indication dans la citation s’impose même si la demande a été déposée en 2024.
42 – Art. 149: Cette disposition vient codifier la jurisprudence (ATF 139 III 478 c. 6.3 et 7.3, note sous art. 149, B. ; Honegger-Müntener/Rufibach/Schumann, p. 1180) relative au recours immédiat en cas de refus de restitution de délai. Son application immédiate est ainsi sans portée.
43 – Art. 167a: Cette disposition permet à une entreprise partie à un litige de se prévaloir d’un droit de refus de collaborer concernant l’activité de son service juridique interne aux conditions de l’art. 167a al. 1. Le droit de refus de collaborer se matérialise lors de l’audition des parties ou des témoins, ayant lieu à partir du 1er janvier 2025. Les preuves obtenues avant l’entrée en vigueur du nCPC ne doivent pas être écartées du dossier, puisqu’elles ont été obtenues licitement (Honegger-Müntener/Rufibach/Schumann, p. 1192 ; contra : BSK ZPO-Willisegger, art. 407f N 20).
44 – Art. 177, et 187 al. 1 3e phr. et al. 2: L’expertise privée fera partie du catalogue des moyens de preuve admis comme titres à la procédure. Les praticiens seront donc bien inspirés d’utiliser ce nouveau moyen de preuve pour les procédures introduites avant l’entrée en vigueur de la révision et qui se poursuivent après le 1er janvier 2025 (contra : Honegger-Müntener/Rufibach/Schumann, p. 1192 qui ne voient pas l’incidence de ces dispositions sur les procédures en cours). Après l’entrée en vigueur de la révision du CPC, si l’expertise privée a déjà été produite à titre d’allégation, elle se transforme à notre avis ex lege en moyen de preuve. Si elle n’a pas encore été présentée et si la phase d’allégation a déjà été clôturée (selon l’art. 229, dont la version révisée ne figure pas à l’art. 407f), la partie pourrait invoquer ce moyen de preuve au titre de nova improprement dit (art. 229 al. 1 let. b ; Tappy, N 25).
45 – Art. 198 let. bbis, f, h et i, et 199 al. 3: L’art. 198 révisé énonce des cas de figure supplémentaires dans lesquels la conciliation n’a pas lieu (en cas d’action concernant la contribution d’entretien des enfants mineurs et majeurs et d’autres questions relatives au sort des enfants ; dans les litiges qui sont de la compétence d’une instance cantonale unique en vertu de l’art. 7 ; en cas d’action qui doit être introduite dans un délai fixé par le tribunal, ou pour les actions qui sont jointes et connexes à celle-ci et en cas d’action devant le Tribunal fédéral des brevets). L’art. 199 al. 3 a également été révisé et permet à présent au demandeur d’introduire une requête de conciliation ou d’introduire l’action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l’art. 5, 6 ou 8. Puisque ces dispositions sont citées à l’art. 407f, le tribunal saisi directement de la demande au fond avant le 1er janvier 2025 ne devrait pas déclarer les demandes irrecevables faute de conciliation, ce afin d’éviter tout formalisme excessif. Il ne se justifie en effet pas de rendre une décision d’irrecevabilité et de demander au demandeur de réintroduire son action, alors qu’il est possible pour le tribunal de suspendre la cause jusqu’au 1er janvier 2025 (art. 126), date à partir de laquelle les dispositions précitées s’appliquent et guérissent l’irrecevabilité. À noter que cela ne concerne que les actions tombant sous l’art. 8, puisque celles tombant sous les art. 5 et 6 ne font pas l’objet d’une conciliation préalable sous le CPC non-révisé (art. 198 let. f). Le même raisonnement peut être mené pour les demandes indépendantes en entretien de l’enfant déposées à tort devant le tribunal en 2024 sans réaliser les conditions de l’art. 198 let. bbis du CPC non-révisé. Les praticiens sont donc rendus attentifs au fait que la procédure de conciliation peut d’ores et déjà être évitée dans ces cas de figure, à condition que la cause soit suspendue par le tribunal saisi de la demande au fond. À souligner enfin que la modification de l’art. 198 let. h CPC, impliquant avant tout la possibilité de conclure à l’inscription définitive de l’hypothèque légale et au paiement de la créance garantie par gage dans la même demande, n’a de véritable portée que si l’on admet (à tort, selon nous) que selon le CPC non-révisé, il n’est pas possible de cumuler une demande dispensée de conciliation et une demande soumise à conciliation (sur la question cf. Bastons Bulletti, note in newsletter CPC Online 2022-N17 du 25 août 2022).
46 – Art. 206 al. 4: Les parties sont rendues attentives à l’application immédiate de cette disposition qui vise à punir de l’amende une partie défaillante à une audience de conciliation ayant lieu à partir du 1er janvier 2025, même si la requête en conciliation a été introduite avant cette date (Heinzmann, N 61). Compte tenu du délai d’ordre de l’art. 203 al. 1, selon lequel l’audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l’échange d’écritures, seules des procédures de conciliation introduites en fin d’année 2024 devraient être concernées.
47 – Art. 210 al. 1 phrase introductive et let. c: Les parties garderont à l’esprit que l’autorité de conciliation pourra faire une proposition de décision pour les litiges patrimoniaux d’une valeur litigieuse jusqu’à CHF 10’000.-. Compte tenu du délai d’ordre de l’art. 203 al. 1, les procédures de conciliation introduites en fin d’année 2024 sont principalement concernées par cette règle (Heinzmann, N 65).
48 – Art. 239 al. 1, 318 al. 2 et 327 al. 5: Ces dispositions s’adressent aux tribunaux. Leur mention à l’art. 407f permet de s’assurer qu’elles soient appliquées le plus rapidement possible. Pour les décisions rendues sur appel ou recours, il en résulte que dès le 1er janvier 2025, l’arrêt motivé ne devra être notifié que si l’une des parties le requiert, conformément à l’art. 239 al. 2, dans un délai de 30 jours (art. 112 al. 2 2e phr. LTF, lex specialis réservée par l’art. 239 al. 3) à compter de la notification du dispositif (comp. ATF 142 III 695 c. 4.1-4.2, notes sous art. 239 al. 3 et sous art. 318 al. 2, pour l’art. 318 al. 2 CPC non-révisé).
49 – Art. 315 al. 2 à 5, 325 al. 2, et 336 al. 1 et 3: Ces nouvelles dispositions permettent notamment à l’appelant ou au recourant de requérir de l’autorité d’appel ou de recours l’effet suspensif ou l’exécution anticipée, des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. L’effet anticipé de ces dispositions permet aux parties de faire une telle requête à partir du 1er janvier 2025, même si seul le dispositif de la décision leur a été notifié, pourvu que le délai pour demander la motivation et/ou le délai d’appel ou de recours ne soient pas écoulés (art. 315 al. 5 et 325 al. 2 nCPC; cf. ég. art. 336 al. 3 nCPC). L’art. 315 al. 2 nCPC prévoit qu’un appel ayant pour objet un avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d’entretien n’a pas d’effet suspensif. Un tel appel introduit avant le 1er janvier 2025 pourrait à notre avis faire l’objet d’une requête en exécution anticipée selon l’ancien droit (art. 315 al. 2 CPC) dans l’attente du 1er janvier 2025 et de l’application du droit révisé.
50 – Art. 317 al. 1bis: L’application immédiate de cette disposition n’a pas de réelle portée, puisque celle-ci se limite à codifier la jurisprudence selon laquelle des faits et des moyens de preuve nouveaux sont admissibles devant l’instance supérieure lorsque l’affaire est soumise à la maxime inquisitoire au sens strict (ATF 144 III 249 c. 4.2.1, note sous art. 317 al. 1, B.a.b.; Silas, N 122).
51 Les dispositions ne figurant pas à l’art. 407f ne seront appliquées qu’aux procédures introduites à partir du 1er janvier 2025 (supra N 23). Puisque certaines dispositions révisées sont favorables aux parties, celles-ci pourraient vouloir ajourner le dépôt de la requête de conciliation ou de la demande au fond. C’est notamment le cas des dispositions sur les frais. L’art. 98 al. 1 nCPC dispose que le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés, sous réserve des cas listés à l’al. 2. En l’absence d’urgence, il est ainsi intéressant pour une partie d’attendre le 1er janvier 2025 pour faire débuter la litispendance, afin d’avancer des frais judiciaires réduits de moitié (Heinzmann, N 79). Cet avantage se manifeste également et surtout lors du règlement des frais. L’art. 111 al. 1 nCPC, qui n’est pas énuméré à l’art. 407f, prévoit que la compensation des frais judiciaires par les avances de frais se produit lorsque la partie qui a avancé les frais supporte la charge des frais. Les cantons supportent le risque d’encaissement dans les autres cas (Honegger-Müntener/Rufibach/Schumann, p. 1177). La partie demanderesse qui doit fournir une avance de frais selon l’art. 98 ou la partie qui a avancé les frais pour l’administration d’un moyen de preuve en vertu de l’art. 102 n’aura plus à se retourner contre sa partie adverse ayant succombé pour récupérer ses avances. Un tel avantage n’est pas négligeable, principalement en présence d’avances de frais importantes ou d’un risque d’insolvabilité de la partie adverse.
52 Au contraire, d’autres dispositions révisées privent les parties de certains avantages. C’est le cas de l’art. 106 al. 3 nCPC – non visé par l’art. 407f – qui restreint à la consorité nécessaire la possibilité pour le tribunal d’imposer une responsabilité solidaire des frais de justice (Honegger-Müntener/Rufibach/Schumann, p. 1176), corrigeant ainsi une jurisprudence jugée trop stricte en cas de consorité simple (ATF 147 III 529 c. 4.3.2, note sous art. 106 al. 3).
53 En adoptant l’art. 407f, le législateur a visiblement cherché un compromis entre l’application immédiate de l’ensemble des dispositions révisées et une application différée permettant aux procédures en cours de se terminer sans interférence du CPC révisé. Le compromis pose toutefois plus de questions qu’il n’en résout. L’application immédiate des dispositions aurait été tout à fait pertinente et facilement applicable, puisque la révision du CPC ne bouleverse pas le système connu jusqu’ici. Afin d’assurer une mise en œuvre rapide du CPC révisé, nous préconisons d’interpréter la notion de « procédure en cours » en distinguant les trois principales phases d’un procès civil au niveau cantonal.
Bibliographie :
Balmer Dominik, Die falsche Rechtsmittelbelehrung (Art. 52 Abs. 2 nZPO), SZZP/RSPC 5/2024 p. 557 ss.
Bastons Bulletti Françoise, Cumul d’une action soumise à la procédure de conciliation et d’une action qui en est dispensée : l’exception qui infirme la règle, Newsletter CPC Online du 25 août 2022.
Bohnet François/Dupont Anne-Sylvie (édit.), CPC 2025 – La révision du Code de procédure civile, Neuchâtel 2024.
Brunner Alexander/Gasser Dominik/Schwander Ivo (édit.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, 2 vol. (cité : DIKE ZPO-AUTEUR).
Chabloz Isabelle/Dietschy-Martenet Patricia/Heinzmann Michel (édit.), Code de procédure civile, Petit commentaire, Bâle 2020 (cité : PC CPC-AUTEUR).
Heinzmann Michel, Les nouveautés en matière de conciliation, in : Bohnet François/Dupont Anne-Sylvie (édit.), CPC 2025 – La révision du Code de procédure civile, Neuchâtel 2024, p. 65 ss.
Hofmann David/Lüscher Christian, Le Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023.
Honegger-Müntener Patrick/Rufibach Matthias/Schumann Julius, Die Revision der ZPO, PJA 10/2023, 1157 ss.
Schneider Silas, Die familienverfahrensrechtlichen Auswirkungen der Revision der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) vom 17. März 2023, in : Lötscher Cordula/Thurnherr Daniela/Wohlers Wolfgang (édit.), Impulse zur praxisorientierten Rechtswissenschaft, Zurich/Genève 2024.
Spühler Karl/Tenchio Luca/Infanger Dominik (édit.), Basler Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd., Bâle 2024 (cité : BSK ZPO-AUTEUR).
Tappy Denis, Le droit transitoire applicable aux règles introduites par la novelle du 17 mars 2023, in : Bohnet François/Dupont Anne-Sylvie (édit.), CPC 2025 – La révision du Code de procédure civile, Neuchâtel 2024, p. 211 ss.